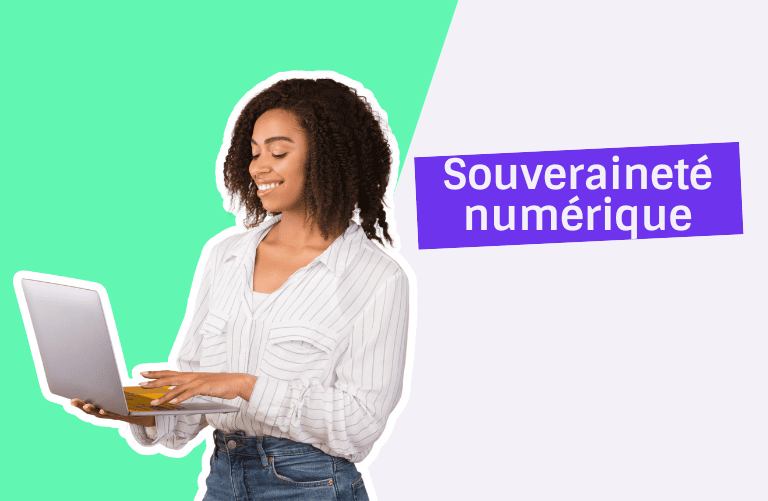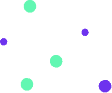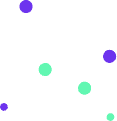Dans notre quotidien hyperconnecté, nous utilisons des services numériques sans même y penser : mails, messageries, cloud, outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc. Mais une question se cache derrière cette apparente simplicité : qui contrôle réellement les outils et les données que nous utilisons ?
C’est ici qu’entre en jeu la souveraineté numérique.
La souveraineté, appliquée au numérique
Traditionnellement, la souveraineté, c’est la capacité d’un État à décider de ses propres lois, sans ingérence extérieure.
Transposée au numérique, elle se définit comme la possibilité, pour un pays (ou une organisation), de contrôler son environnement numérique et les données qui y circulent.
Autrement dit, il s’agit de savoir :
- Qui héberge nos données
- Qui fixe les règles (et quelles lois s'appliquent)
- qui possède la technologie qui fait tourner nos services numériques
Sans ce contrôle, la liberté de choix reste en apparence, mais la dépendance est bien réelle.
Une affaire d’indépendance (mais pas d’isolement)
La souveraineté numérique ne signifie pas « couper internet » ou vivre en autarcie technologique. Aucun pays ne peut tout fabriquer, du microprocesseur aux câbles sous-marins.
Il s’agit plutôt de limiter les dépendances critiques, afin de rester maître de ses décisions même lorsqu’on utilise des technologies venues d’ailleurs.
Un bon exemple : le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Avec ce texte, l’Europe a posé ses propres règles de protection des données, et exige que tout acteur, européen ou étranger, les respecte dès lors qu’il traite des données de citoyens européens.
Les deux piliers de la souveraineté numérique
-
1- La maîtrise des technologies
Infrastructures, logiciels, services cloud… Pouvoir s’appuyer sur des solutions locales ou européennes évite une dépendance totale aux géants étrangers.
-
2- Le contrôle des données
Savoir où elles sont stockées, qui y accède, et sous quelle juridiction elles tombent. Si vos données sensibles sont hébergées à l’étranger, vous êtes aussi soumis aux lois de ce pays (ex. Cloud Act américain).
Pourquoi c’est un sujet majeur aujourd’hui ?
Parce que le numérique est devenu un enjeu de puissance. Les données sont qualifiées de nouvel « or noir » : elles ont de la valeur économique, stratégique et même politique.
Sans souveraineté numérique :
- Un État peut voir ses décisions influencées par des lois étrangères
- Une entreprise peut être fragilisée par des dépendances technologiques
- Un citoyen peut perdre la maîtrise de sa vie privée
Pour aller plus loin
Cet article pose les bases de la souveraineté numérique, mais le sujet est vaste et touche aussi bien au droit, à la géopolitique qu’aux choix technologiques.
Si vous souhaitez approfondir :
- Vie publique : Définition et enjeux de la souveraineté numérique : une analyse détaillée des concepts et des enjeux politiques.
- Next.ink : La souveraineté en 10 questions : une approche pédagogique et accessible, qui rend le sujet clair et concret.
Ces ressources complètent et prolongent la réflexion pour comprendre pourquoi la souveraineté numérique est aujourd’hui un enjeu stratégique majeur pour les États, les entreprises et les citoyens.